De la BRI à la librairie
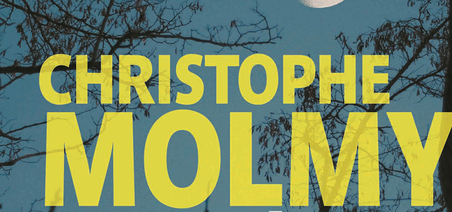
Il y a eu les pionniers : Roger Borniche, Hugues Pagan, Roger Le Taillanter, Danièle Thierry, Philippe Isard… tous policiers, devenus incontournables dans l’univers du polar, après avoir franchi le Rubicon de la littérature.
Le phénomène s’est accéléré ces dernières années et, aujourd’hui, de plus en plus d’auteurs de polars affichent dans leur CV une expérience dans la maison, en PJ la plupart du temps. Le succès de ces auteurs, auprès des maisons d’édition comme auprès des lecteurs, repose bien souvent sur une promesse implicite : celle du réalisme. Même si le livre est une fiction, il ne saurait mentir. Christophe Molmy, chef de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la préfecture de police (la fameuse Antigang du 36) a rejoint la « confrérie » des policiers romanciers en 2015, avec la publication de son premier roman, Les loups blessés. Fort d’un certain succès public et critique, le commissaire publie en 2018 son deuxième roman, Quelque part entre le bien et le mal. Le troisième, Après le jour, vient de sortir cet été. Rencontre au cœur de l’été parisien avec le policier, dans son bureau du mythique 36 quai des Orfèvres.
Christophe Molmy, commençons par l’inévitable question que tout le monde se pose face à un policier qui s’est lancé dans l’écriture de romans : qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ?
Christophe Molmy : Une envie, mais celle-ci n’est pas arrivée d’un coup. Aucun écrivain ne se dit un beau jour en se réveillant le matin : tiens, je vais écrire un livre. J’en ai d’ailleurs discuté avec d’autres auteurs, et tous m’ont confié qu’ils avaient toujours écrit, et ce dès l’enfance. C’est mon cas, j’ai toujours été très à l’aise avec l’écrit. De plus j’ai lu, dès mon plus jeune âge, de nombreux romans policiers qui ont forcément nourri cette envie d’écrire.
Quels types de romans policiers ?
CM : Au départ, des livres qui appartenaient à mon père, des livres de grands flics comme ceux de Borniche ou les mémoires de Broussard, que j’ai eu la chance de rencontrer par la suite. Je ne lisais pas que ça, mais ceux-ci m’ont particulièrement marqué. A cet amour du polar s’est agrégé un événement qui m’a beaucoup marqué lorsque j’étais enfant : Mesrine a été neutralisé par Broussard à quelques centaines de mètres du domicile de ma grand-mère. Ces lectures et cet événement, qui ont nourri mon imaginaire, ont été déterminants dans ma décision de devenir policier.
Mais pas de devenir écrivain ?
CM : Non, je voulais être policier. C’est après voir intégré la police que l’envie d’écrire a ressurgi et ce, pour plusieurs raisons. Je trouvais que, dans les nombreux polars que je lisais, il manquait certains éléments. Tout d’abord, l’énorme majorité d’entre eux portent sur des affaires criminelles. Il n’existait quasiment rien sur le banditisme. D’ailleurs, quand vous discutez de polars avec des lecteurs, ils citent immanquablement des bouquins sur des enquêtes criminelles. Je trouvais cela dommage car le banditisme est un domaine riche et fascinant qui pouvait donner de fabuleux romans. La deuxième chose qui me chagrinait, c’est que la plupart d’entre eux, même servis par un style excellent, étaient truffés d’erreurs et manquaient de réalisme. Il y a une dizaine d’années, je me suis dit qu’il serait intéressant d’écrire un roman policier réaliste sur le banditisme et je me suis lancé dans l’écriture. Je l’ai écrit pour moi au départ, sans intention de le publier. J’ai mis du temps, je sentais que les premiers essais n’étaient pas brillants. J’ai ensuite donné une version à un ami qui, trouvant cela bon, m’a encouragé à poursuivre. Et sans me le dire, il a envoyé une copie aux maisons d’édition. Un jour, je reçois un appel des éditions de la Martinière qui m’annonce qu’ils souhaitaient me publier. Passé la surprise, j’ai accepté, à condition de le faire sous pseudo. Eux ne voulaient le publier que sous mon vrai nom, au motif qu’un livre écrit par un flic spécialisé dans le banditisme est beaucoup plus vendeur. J’ai finalement accepté, le livre est sorti, a bien marché, et ils m’ont poussé à continuer.
Le souci du réalisme fut donc l’une des raisons qui vous a poussé à écrire. Etes-vous, sur ce point, satisfait du résultat ?
CM : Par nature, j’ai toujours des regrets quand un roman est terminé. Quand la maison d’édition vous envoie la dernière version avant publication, vous estimez toujours qu’il manque quelque chose : que vous n’avez pas été au bout de votre idée, que l’histoire n’est pas aboutie, que certains personnages manquent de chair… mais je m’efforce toujours de mettre un point final à l’écriture, sinon vous ne finissez jamais. Mais en règle générale, je pense avoir assez bien décrit le travail des policiers et le milieu dans lequel ils évoluent.
L’univers policier
Que pensent les autres policiers de vos romans ?
CM : C’est assez étrange mais, à part les gens très proches dans la boite qui me disent qu’effectivement, ils ont l’impression d’être au boulot quand ils me lisent, j’ai très peu de retours d’autres collègues. La plupart ne m’en parlent pas. Il y a une forme de distance.
Ils vous considèrent peut-être avant tout comme policier et ne voient pas le romancier ?
CM : Peut-être. J’ai pourtant toujours pris soin de dépeindre la maison objectivement et jamais à charge. Je sais que certains romanciers qui étaient policiers ont quitté la boite en claquant la porte et grossissent le trait quand ils écrivent sur la police. Je ne le ferais jamais car je fais le métier que j’ai toujours voulu faire, je suis arrivé là où je voulais aller et j’ai participé à de superbes affaires. J’essaye aussi de partager cela dans mes romans, et si mes bouquins permettent de faire naître une vocation parmi mes lecteurs, ce serait une belle réussite. Et je sais que cela est déjà arrivé.
Avez-vous des contacts avec d’autres policiers qui ont déjà publié ?
CM : On se connait, on se parle parfois mais ça ne va pas plus loin. Il n’y a pas un club de policiers écrivains. Nous faisons d’ailleurs des romans bien différents. Les parcours, les histoires et les styles ne sont pas les mêmes.
Il n’y a pas un style propre aux policiers ?
CM : Non, il y a juste une forme de réalisme qu’on ne sent pas chez d’autres auteurs. Il y a aussi une chose qu’un policier peut faire passer dans ses romans, une chose que j’ai comprise à mes débuts mais que je n’ai formalisée que plus tard : rien n’est noir ou blanc. La réalité ne peut être décrite de façon manichéenne. Les voyous que vous êtes amenés à côtoyer, surtout dans le banditisme, ne sont pas complétement tordus. Ce ne sont pas des monstres. Certains braqueurs de fourgons sont de bons pères de famille attentionnés, amoureux de leur femme, voisins aimables. C’est assez troublant parfois et on se pose toujours la question : qu’est-ce qui fait qu’une part de cette personne est saine et l’autre dérive complétement ? Il nous est arrivé d’avoir en garde à vue des voyous avec un sacré pédigrée, et qui s’avéraient pourtant drôles, intéressants voire brillants et intelligents. Quand vous êtes policiers, vous ne leur cherchez pas d’excuses, vous faites votre boulot. Mais, dans un roman, vous pouvez toujours fouiller cette matière humaine et en tirer quelque chose.
Vous devez surement rencontrer vos lecteurs sur les salons ou à l’occasion de dédicaces. Que vous disent-ils ?
CM : La première chose qui m’a surpris, c’est que le lecteur de romans policiers est avant tout une femme. Je ne m’y attendais pas du tout, surtout dans le domaine sur lequel j’écris, le banditisme, qui est souvent très violent. Et elles apprécient ces histoires et surtout leur côté réaliste. Elles me confient qu’elles apprécient le fait que ces histoires soient véridiques, ce qui n’est pas toujours vrai car je suis obligé de m’arranger avec la réalité, je travestis parfois car je ne peux pas relater une affaire qui s’est réellement passée, et puis il m’arrive de prendre certaines libertés par rapport aux règles du métier. J’ai même reçu récemment un mail presque incendiaire d’une greffière qui m’a reproché une erreur sur un point de procédure.
Mais un roman ne peut se résumer à un compte-rendu rigoureux d’enquête ?
CM : Je suis d’accord, et s’il y a un endroit où vous pouvez prendre des libertés avec la procédure, c’est bien dans un roman. Pour en revenir aux lecteurs, certains me demandent derrière quel personnage je me cache, alors que j’ai toujours fait en sorte que les personnages ne revêtent jamais les traits d’un collègue ou d’un voyou. Ce qui m’intéresse avant tout c’est le fonctionnement d’un groupe d’enquête ainsi que les affaires sur lesquelles il travaille.
Certaines critiques ont été utiles ?
CM : Après la parution de mon premier roman, quelques critiques reprochaient aux personnages de manquer de chair. Et c’était totalement justifié. En fait, j’avais fait l’erreur de prendre pour personnage principal un commissaire de police. Ça m’a complétement inhibé. Je me suis rendu compte que, par peur d’être identifié à ce personnage, j’avais beaucoup de mal à décrire sa vie en dehors du métier. J’ai corrigé le tir pour le second roman, en prenant comme personnage central, une jeune gardienne de la paix. Je me suis senti beaucoup plus libre.
Toujours se renouveler
Avez-vous beaucoup évolué dans votre façon d’écrire depuis le premier roman ?
CM : Sur la méthode, non. Je fonctionne toujours de la même manière : je pars d’une scène, je bâtis un synopsis autour de celle-ci, et j’écris les chapitres dans l’ordre chronologique de l’histoire. Pour mon deuxième roman, l’idée de départ était de décrire une audition, et le roman s’est construit autour de cette envie. Par contre, j’ai gagné en aisance dans l’écriture de certaines choses. J’éprouvais notamment certaines difficultés dans la description des lieux. Aujourd’hui, je m’en amuse. J’ai également progressé sur la façon de tenir le lecteur sur la durée, de l’envoyer sur des fausses pistes, de le perdre, avant de le ramener sur l’histoire. Mais la grande difficulté, pour chaque nouveau roman, est de se renouveler : Après le premier roman, j’aurais pu, par facilité, écrire quinze livres sur les attaques de fourgon blindés, mais quel intérêt ? J’ai toujours fais en sorte d’innover pour mon propre plaisir : pour le second, je me suis ainsi glissé dans la tête d’une jeune policière confrontée à un tueur pulsionnel, et pour le troisième, je souhaitais mettre en avant les relations des policiers avec les indics.
Certains aspects du travail policier ressortent de votre livre, qui peuvent sembler des détails mais qui sont assez marquants. Je pense au fait que les policiers de PJ passent un temps fou dans leur voiture et qu’ils travaillent constamment en groupe ?
CM : Ce dernier point est fondamental. Il faut arrêter de croire, - et j’en parle parfois à d’autres auteurs de romans policiers -, que les enquêtes menées par un flic solitaire ou un binôme sont la règle dans la police. L’ADN de la PJ, c’est le groupe. Ça n’existe pas le policier qui travaille seul sans rendre compte des avancées de son enquête. Quant aux voitures, il est vrai que tous les policiers de PJ ont passés des jours et des nuits à poireauter en voiture sur leurs enquêtes. Ça pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un bouquin entier. Une équipe en surveillance toute une nuit sans qu’il ne se passe grand-chose. Ce serait très réaliste, mais bon, est-ce que ça aurait un quelconque intérêt pour le lecteur ? Et puis aujourd’hui, la police dispose de moyens qui lui permettent de réduire ces moments d’attente en bagnole.
Avez-vous entendu parler d’une adaptation possible de vos romans à l’écran ?
CM : C’est dans l’air, certains projets ont émergés puis ont été abandonnés, mais je m’en désintéresse un peu.
Qu’un réalisateur s’approprie votre roman, et en livre une interprétation personnelle, ne vous intéresse pas ?
CM : Vous savez, si ça se fait, les droits seront achetés à la maison d’édition, pas à moi. Je ne serais pas nécessairement inclus dans le processus
Vous n’avez pas votre mot à dire dans ce type de projet ?
CM : Le seul droit que j’ai, c’est de refuser que mon nom soit associé au projet. C’est d’ailleurs déjà arrivé. Les droits de mon premier roman avaient été achetés pour une future adaptation, et les scénaristes souhaitaient me rencontrer. Leur projet était déjà bien avancé quand ils m’en ont parlé. Mais ils avaient complétement trahi le livre, il ne restait plus rien de l’histoire. Ça partait dans tous les sens, et le pire selon moi, c’est qu’ils tombaient dans les clichés les plus éculés. Leur policier était devenu un ripou ingérable, divorcé, alcoolique et cocaïnomane. J’ai horreur de cette vision simpliste. La grande majorité des policiers avec lesquels j’ai travaillé sont des mecs équilibrés et responsables. Je leur ai donc dit qu’ils s’étaient trompés de bonhomme et j’ai refusé que mon nom y soit associé. Leur projet a été abandonné. J’ai compris ensuite qu’ils souhaitaient disposer de mon nom comme d’une sorte de caution.
Et quid d’un nouveau roman, ce projet est-il en route ?
CM : Oui, mais je ne vous en dirai rien. Je peux seulement vous confier qu’il ne s’agira pas d’un roman policier classique, basé sur une enquête, comme j’ai pu en écrire jusqu’ici. Ce sera plutôt un thriller… Et si un jour, j’en écris un cinquième, je pense que je m’orienterais davantage vers la littérature classique, pour m’affranchir des codes du genre. Enfin, nous verrons bien.



